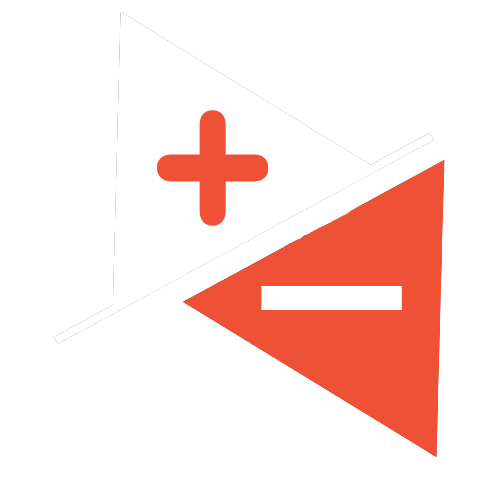La morphine.
Présentation du produit
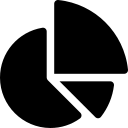
| PLAN |
➔ HISTORIQUE. ➔ L’ÉLABORATION DE LA MORPHINE. ➔ LES MODES DE CONSOMMATION. ➔ LES EFFETS DE LA MORPHINE. |
Analgésique de niveau III, prescrit contre les douleurs intenses, la morphine est un opioïde extrait du pavot. Principal composant actif de l’opium (l’opium contient 70% de morphine), elle est obtenue à partir de l’opium brut ou de la paille de pavot.
La morphine est classée comme stupéfiant et son utilisation est très réglementée pour éviter qu’elle soit détournée de son usage médical.
| HISTORIQUE |
Signalée dès 1688 sous le nom de magistère d’opium, c’est seulement en 1803 que la morphine aurait été isolée par De Rosne en étant alors connue sous l’appellation « Sel de Drosne ».
En 1817, un pharmacien allemand se nommant Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, extrait l’alcaloïde de l’opium qu’il dénomme «Morphium», d’après le nom du dieu du sommeil, Morphée. La paternité de cette découverte a été contestée par Armand Seguin, chimiste français de Napoléon, qui aurait décrit la morphine dans un mémoire de 1804 publié en 1814.
En 1831, ce produit est assimilé par le manuel de matière médicale à la narcotine qui n’est pas à l’époque employée comme un médicament. Dans ce même manuel, on y décrit la morphine à côté des acétate, sulfate, citrate, hydrochlorate et nitrate de morphine comme étant « un principe immédiat de nature alcaline ».
En fait, les véritables expérimentations scientifiques ne débutèrent que lorsqu’on substitua les sels de morphine à l’alcaloïde lui-même.
La morphine fut tout d’abord administrée par voie stomacale.
Grâce à l’invention de la seringue de Prava (1850) et surtout grâce à son utilisation massive par les médecins militaires lors de la guerre de 1870, elle a alors connu une grande vogue et une période notoire.
Utilisée à grande échelle sur les champs de bataille (Crimée (1854-1855), guerre de Sécession aux Etats-Unis (1861-1865)), elle génère alors la «maladie du soldat» qui est la première toxicomanie moderne. Jusqu’en 1900, son usage resta extrêmement répandu avant de connaître une baisse sensible malgré un regain pendant et après la seconde guerre mondiale.
Actuellement, la morphine est toujours l’analgésique classique le plus efficace pour soulager les douleurs aigues.
Son utilisation décroît à mesure qu’apparaissent de nouvelles drogues synthétiques dont on pense qu’elles engendrent moins la dépendance.
| L’ÉLABORATION DE LA MORPHINE |
La morphine est obtenue à partir de l’opium brut ou de la paille de pavot. Ce dernier procédé évite la production de gomme d’opium. L’important volume de paille utilisé par cette technique rend extrêmement difficile les transactions illicites et un important pourcentage de morphine à usage médical est d’ailleurs obtenu par cette fabrication (exemple : laboratoires Francopia, société Française produisant environ 40 tonnes de morphine par an, soit 20% de la production mondiale).
La morphine base (première étape) s’obtient par mélange de l’opium à de l’eau chaude. Le produit obtenu est filtré et soumis à une série de réactions chimiques en milieu basique puis acide. Ces différentes transformations vont permettre au chimiste de fabriquer de la morphine. Très soluble dans l’eau, elle se présente sous l’aspect d’une poudre blanche.
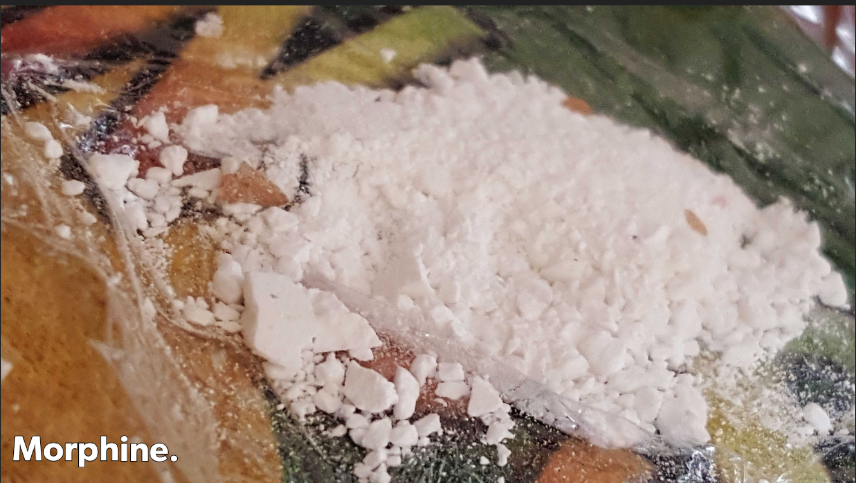
| LES MODES DE CONSOMMATION |
La morphine est présentée en ampoules de chlorhydrate de morphine à un ou deux centigrammes qui sont utilisées comme hypno-analgésique en étant injectée par voie sous cutanée, intraveineuse ou intramusculaire.

Pouvant s’administrer par voie orale, elle connaît alors une action pharmacodynamique plus lente mais qui dure plus longtemps.

Les potions analgésiques à base de morphine ont été préconisées dans le traitement des manifestations douloureuses rencontrées surtout en cancérologie.
L’utilisation de la morphine est actuellement, spécialement en France, en déclin.
Les saisies de ce produit sont en diminution constante depuis ces dernières années.
Il semble que le morphinomane se soit détourné de cette drogue qu’il aurait remplacé par l’héroïne.
| LES EFFETS DE LA MORPHINE |
La morphine exerce au niveau du système nerveux central, une action se traduisant par des effets de somnolence et une modification de l’humeur.
Antalgique très puissant, chez les sujets qui souffrent, elle provoque un certain degré de bien être et quelques fois d’euphorie.
Au niveau du cortex cérébral, la morphine entraîne un ralentissement des facultés d’attention, d’idéation et de mémorisation.
Une utilisation longue à dose élevée provoque des manifestations psychodysleptiques avec des épisodes délirants et hallucinatoires.
Créant une dépendance psychique mais aussi physique, son utilisation prolongée génère une accoutumance induisant une hausse de la consommation. Dépresseur respiratoire, à doses trop fortes, la morphine peut entraîner la mort.