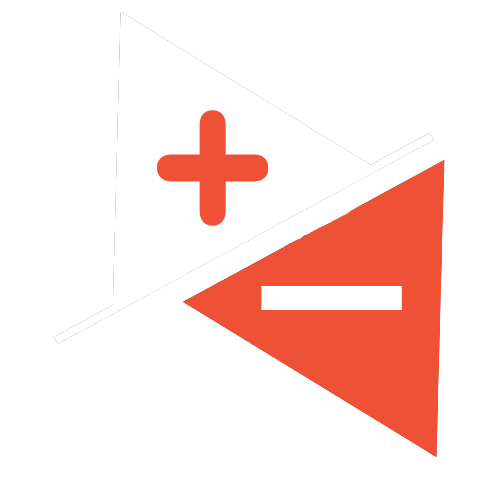LETTRE Q
| DICTIONNAIRE DES TERMES ET ABRÉVIATIONS EMPLOYÉS SUR CE SITE ET DANS LE MILIEU DE LA TOXICOMANIE |
| CHERCHER LA DÉFINITION D’UN MOT PAR SA LETTRE |

| LETTRE Q |
| QUARTIERS (CULTURES DE QUARTIERS) : LE « BUSINESS » COMME SYSTÈME DE VIE : |
Dans un grand nombre de quartiers sensibles, le phénomène de drogue est devenu une réalité tangible, qui fait problème pour la population.
Dans de nombreux quartiers, la consommation de cannabis (fumette, joint, pétard) devient visible, voire s’affiche, parce que dénuée de toute connotation négative. Se fiant à la quasi dépénalisation d’une drogue qualifiée « douce » par rapport à l’héroïne, la plupart des jeunes ignorent que cette consommation relève de la loi de 1970. Pour eux, elle ne constitue même pas une manière de provoquer les adultes et de jouer avec le danger, puisque, tout au contraire, elle leur paraît moins pernicieuse que le tabac et en codifient l’usage. Cette consommation banalisée se fait en groupe, tantôt dans les caves, tantôt dans les lieux publics. Les achats s’opèrent un peu partout, auprès des petits dealers ambulants qui financent ainsi leur propre consommation. Jeunes et généralement dénués de ressources, les consommateurs sont amenés à recourir à la délinquance de profit. Un pas est franchi lorsque les consommateurs de haschisch ne se contentent plus d’aller faire leurs emplettes sur les lieux de revente, mais commencent à faire eux-mêmes la navette entre leur quartier et les lieux d’approvisionnement. Cette pratique suppose une certaine organisation, souvent à plusieurs, pour rentabiliser les déplacements en entraînant vite le recours à une petite revente. Toutes ces « fourmis » découvrent ainsi le monde du « business » à petite échelle. Les chiffres d’affaires augmentent peu à peu, et, avec eux, la petite délinquance de profit également. La situation s’aggrave lorsque des voitures souvent puissantes apparaissent au sein du quartier en étant conduites par des livreurs de drogue. La noria des véhicules de clients extérieurs et les afflux de consommateurs en attente de livraison commence aux alentours du domicile du revendeur local.
Le trafic ayant déjà pris ces formes et ces dimensions se fait alors remarquer. Il suscite des réactions viscérales au sein de la population : sentiment spécifique d’insécurité.
Sous la pression de la concurrence, le « business » se rationalise et se concentre entre quelques mains. Des familles dénuées de ressources officielles commencent à manifester des signes extérieurs d’aisance : voitures puissantes, vêtements de luxe, fréquents voyages vers les pays de production … Toute une frange du quartier bénéficie d’heureuses retombées et les rabatteurs obtiennent leurs doses en échange de leur contribution au trafic. Alors se constitue un nouvel ordre social, fondé sur l’étalage d’une richesse facilement acquise qui éblouit les plus jeunes. Certains parents ferment les yeux sur les ressources des adolescents, voire des enfants et vont parfois jusqu’à participer au trafic.
Des violences spécifiquement liées au « business » se font jour entre les bandes s’affrontant au nom de rivalités commerciales. La violence émane le plus souvent du dealer, chez lequel l’appât du gain aggrave très rapidement le cynisme et le mépris de la vie d’autrui. Parfois, c’est l’acheteur insatisfait qui revient sur place accompagné de « justiciers ». La violence urbaine ayant cours dans un certain nombre de quartiers favorise la mise en place de l’économie souterraine. Les comportements de jeunes désœuvrés occupant l’espace public sont toujours de nature essentiellement ludique ou liées à une volonté de représailles, voire à des sentiments de révolte de la part de jeunes dramatisant à l’excès et refusant leur marginalisation sociale. Ainsi, les jeunes livrés à eux-mêmes dans les interstices de l’espace public reconstituent une socialité marginale et glissent peu à peu dans la petite délinquance.