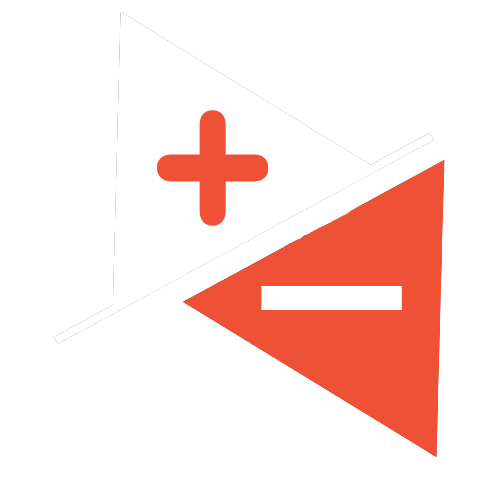Les solvants.
Présentation du produit
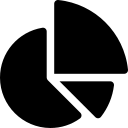
| PLAN |
➔ HISTORIQUE. ➔ LES MODES DE CONSOMMATION DES SOLVANTS. ➔ LES EFFETS RECHERCHÉS. ➔ L’INTOXICATION AUX SOLVANTS. ➔ L’ACTION DES SOLVANTS. |

| HISTORIQUE |
Dès le XIX siècle et dès 1830, dans le milieu estudiantin, les «éther parties» étaient très en vogue aux Etats-Unis. Le docteur Long, médecin, avait déjà observé l’insensibilité à la douleur développée chez les toxicomanes consommant de l’éther. En ayant déduit une application médicale, en mars 1942, après lui avoir fait inhaler des vapeurs d’éther, il opéra alors un jeune malade d’une tumeur au cou en donnant ainsi naissance à l’anesthésie générale. Egalement démontrées par le dentiste W. Morton, les propriétés anesthésiques de l’éther ont été définitivement reconnues par les autorités médicales en 1846. Actuellement, en raison de l’évolution des sciences et des pratiques médicales, l’éther n’est plus utilisée comme anesthésique.
Dès le début des années 1960, en Europe (Angleterre, Suède, pays anglo-saxons), de nouvelles pratiques toxicomaniaques, extensions de l’éthéromanie, ont vu le jour par l’inhalation de solvants organiques entrant dans la composition de produits usuels, à usages divers, commercialisés sous diverses formes et appellations.
En France, les effets de l’éther ont été décrits par Guy de Maupassant qui était un adepte de l’éthéromanie. Dans notre pays, les premiers cas de spiromanie aux solvants ont été constatés en 1970 par le biais des centres antipoison. Dans un premier temps, ces comportements sont apparus essentiellement liés à un milieu urbain. Par la suite et à partir de 1975, le phénomène s’est progressivement étendu à l’ensemble du territoire pour atteindre son paroxysme en 1980-1981.
| LES MODES DE CONSOMMATION DES SOLVANTS |
Les techniques de consommation sont nombreuses et résultent du produit et de l’imagination des utilisateurs.
On distingue :
➔ LE SNIFFING DIRECT.
Le sniffing direct se pratique à même le goulot d’une bouteille de solvant, au dessus d’un pot de colle, à l’extrémité d’un tube, sur le réservoir de carburant d’un véhicule (cyclomoteur).
➔ LE SNIFFING DANS LES MAINS.
Le sniffing dans les mains se traduit par une dissolution du produit qui est étalé sur les mains posées en entonnoir et qui sont portées au niveau du nez et de la bouche.
➔ LE SNIFFING DANS UN SAC EN PLASTIQUE.
Le sniffing dans un sac en plastique est un mode de sniffing généralement pratiqué en solitaire. Ce procédé procure des effets plus marqués en raison de la forte concentration inhalée.
➔ LE SNIFFING SUR UN TAMPON.
Le sniffing sur un tampon est un autre mode de sniffing solitaire qui est pratiqué pour l’inhalation des solvants liquides et plus particulièrement des détachants et de l’essence.
➔ LE SNIFFING DES AEROSOLS.
Le sniffing des aérosols s’effectue soit par pulvérisation du produit dans la bouche, soit par inhalation du solvant dans un sac plastique dans lequel il est préalablement propulsé.
| LES EFFETS RECHERCHÉS |
L’inhalation de solvants provoque, dans un premier temps, une sensation d’euphorie qui se manifeste dans les premières minutes de la consommation.
Elle peut parfois, selon les sujets et/ou selon le produit, être précédée de maux de tête, nausées et vertiges.
Cet état, à rapprocher cliniquement du syndrome ébrieux provoqué par l’absorption d’alcool, est générateur d’accidents, de chutes dues aux étourdissements ainsi que de troubles du comportement (sensation de puissance, d’invincibilité, extrême irritabilité, libération des instincts agressifs et des pulsions sexuelles).
A cette phase d’excitation euphorique succède généralement des effets dépresseurs.
| L’INTOXICATION AUX SOLVANTS |
| L’intoxication aigüe |
L’affinité des solvants pour les organes riches en lipides détermine, au niveau de l’intoxication aiguë, l’apparition de troubles touchant le système nerveux central, le cœur, le foie et les reins.
| Les intoxications chroniques |
➔ TOXICITÉ NERVEUSE.
L’atteinte du système nerveux débute par une phase d’excitation.
Celle-ci est suivie d’une phase de dépression (anesthésie, somnolence, troubles de la conscience), puis d’un coma plus ou moins profond pouvant aboutir à la mort.
A la sortie de ce coma peut apparaître un syndrome prénarcotique (ivresse, somnolence, vertiges, fatigue …) qui sera plus ou moins long à se dissiper et qui pourra engendrer des chutes et des accidents.
➔ TOXICITÉ CARDIAQUE.
Certains solvants (chloroforme, trichloréthylène) peuvent déclencher une hyperexcitabilité du myocarde. Une défaillance cardiaque (fibrillation ventriculaire) peut alors survenir en étant responsable de la mort brutale qui a déjà été constatée chez des toxicomanes ayant respiré des doses massives de solvants.
➔ TOXICITÉ TRADUITE PAR UNE ACTION SUR LA PEAU ET LES MUQUEUSES.
De nombreux dérivés polychlorés (chlorure de méthylène, chloroforme, trichloréthylène …) ou nitrés (nitro 2 propane) provoquent, en cas de contact avec ces organes, de vives irritations de la peau et des yeux (kératites et des conjonctivites).
| L’ACTION DES SOLVANTS |
L’usage intensif et prolongé de nombreux solvants liposolubles entraînent une atteinte souvent irréversible au niveau des organes : système nerveux, foie, reins, moelle osseuse, poumons.
Selon la capacité de ces divers organes à transformer des substances exogènes comme les solvants, une intoxication à long terme peut se manifester avec une sélectivité variable : certaines atteintes seront réversibles (troubles hépatiques et rénaux) et d’autres irréversibles (anémie aplastique, cancers …).
| Action sur le système nerveux |
➔ SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.
La majorité des solvants sont des toxiques chroniques du système nerveux central dont l’intensité est néanmoins très variable.
Certains (toluène, trichloréthylène, sulfate de carbone …) peuvent déclencher, en cas d’intoxication sévère, l’apparition d’un syndrome psycho-organique caractérisé par des troubles amnésiques (difficultés d’attention, de mémorisation), troubles de l’intelligence (atteinte du raisonnement), troubles de l’affectivité et de la personnalité (irritabilité), fatigabilité, baisse de la libido, tendance dépressive.
Ces mêmes solvants peuvent occasionner des atteintes profondes du système nerveux central (atrophie du cerveau, du cervelet).
Le toluène et le xylène peuvent conduire à des dégénérescences profondes de ces mêmes organes qui peuvent être concernés par des troubles neurovégétatifs (transpiration anormale, palpitations, vertiges, troubles digestifs).
➔ SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE.
Quelques solvants entraînent une atteinte du système nerveux périphérique (polynévrites). Par exemple, le méthanol agit au niveau du nerf optique et, l’atrophiant, peut occasionner des cécités totales et irréversibles.
➔ ACTION SUR LE FOIE ET LES REINS.
Les solvants sont métabolisés au niveau du foie, puis éliminés par les reins. De ce fait, ces organes subissent des altérations se soldant par des ictères et des néphrites.
➔ ACTION SUR LA PEAU ET LES MUQUEUSES.
Quelques produits (essence de térébentine) provoquent des dermites allergiques (eczéma) alors que l’acétone produit une action irritante sur les muqueuses des voies aériennes supérieures.
➔ ACTION SUR LE SANG.
Plusieurs solvants azotés (nitro-alcanes, nitrobenzène, amiline) transforment l’hémoglobine en méthamoglobine qui est incapable d’assurer le transport de l’oxygène. Cette action se traduit par une cyanose ardoisée (coloration bleuâtre des muqueuses et de la peau), avec une anémie hémolytique plus ou moins prononcée. L’inhalation de solvants tels que le benzène, le toluène, le trichloréthylène peut provoquer de aberrations chromosomiques.
➔ POUVOIR CANCEROGÈNE.
Seul le benzène est reconnu comme cancérogène pour l’homme.
➔ PROPRIÉTÉS EMBRYOTOXIQUES.
La plupart des solvants traversent facilement la barrière placentaire. De ce fait, des malformations et des avortements spontanés seraient à craindre chez des enfants issus de mères toxicomanes. L’âge moyen des adeptes féminins du sniffing permet à priori d’écarter ce danger supplémentaire.

L’inhalation de solvants engendre une tolérance certaine et des décès dus à des surdosages ont déjà été médicalement constatés.
Si l’inhalation de solvants, en tant que pratique toxicomaniaque, peut constituer une phase transitoire préludant à l’usage de stupéfiants, il est difficile à ce jour, en l’absence de données objectives d’en évaluer et la réalité et, le cas échéant, le rapport de proportionnalité.